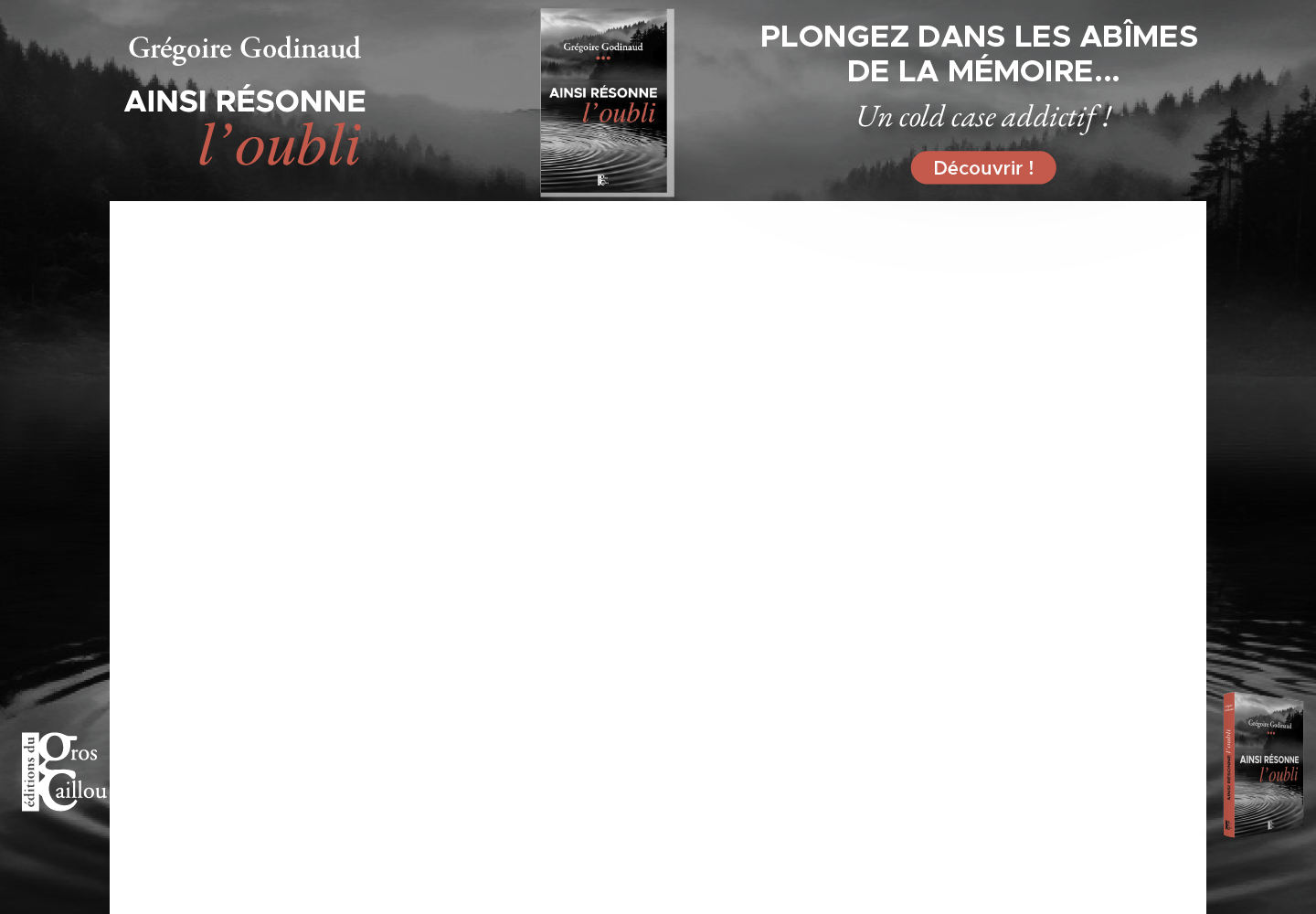Comment sont nées ces Fleurs de cimetière ? De quel désir ?
Edmond Baudoin : Je crois avoir été l'un des premiers en France à mener ce genre de projets autobiographiques, lorsque j'ai rencontré Étienne Robial et commencé à être publié chez Futuropolis [en 1981 NDLR]. Mais des dessinateurs américains comme Robert Crumb avaient déjà fait cela avant moi. Mon idée de base cette fois-ci, c'était d'écrire mon journal jusqu'à ma mort, jusqu'à ce que ne puisse plus dessiner ni écrire. C'est peut-être la lecture du Journal d'un corps de Daniel Pennac qui m'a donné cette idée. Je voulais au départ un livre sans images et peu à peu, presque malgré moi, le dessin est venu s'introduire dans le texte. Et puis est arrivée l'épidémie de Covid. Je sentais qu'il allait se passer quelque chose d'important, je devinais que nous ne pourrions plus continuer comme ça, qu'il allait nous falloir réfléchir à une autre manière de vivre. Voilà pourquoi, bien que je ne sois pas mort (rires...), j'ai décidé d'en rester là, au commencement de cette pandémie.
Comment avez-vous composé ce livre qui est fait d'allers et retours permanents entre le dessin et l'écriture, entre les époques aussi ?
Au fond, on ne crée rien, on recrée. La forme s'invente d'elle-même et c'est la difficulté qui m'oblige à inventer. Je voulais comme toujours parler aux autres, leur dire notre commune humanité. Je ne suis qu'un être humain, bien sûr, avec les mêmes joies, les mêmes misères. Mais il est vrai que ma manière de vivre, elle, n'est pas habituelle. J'ai été « fait » d'abord par les femmes que j'ai aimées ; et je comprendrais que cela puisse en quelque sorte rebuter le lecteur. Aussi, le dessin m'a amené à vivre des choses que tout le monde ne vit pas nécessairement, ou au moins différemment. Pour ce livre, je me suis ainsi beaucoup aidé de mes carnets de dessins et de notes que je trimballe partout avec moi. Ils sont à l'origine de tout. Je me suis aidé de la danse également, qui a toujours été si importante pour moi. Et puis, sans prétention, j'ai pensé à Gilles Deleuze qui disait que tout est à plat de ce qui est de notre histoire.
Parlons de ces arbres, majestueux, torturés aussi, qui viennent scander ce livre comme autant de têtes de chapitres, voire de commentaires...
Ce sont mes carnets qui ont amené dans mes livres la représentation des arbres. Tous les arbres que je dessine, je le fais face à eux, en direct si j'ose dire. Là également, chacun d'entre eux a à voir avec mon autre grande passion qui est la danse. Et puis ces arbres écorchés sont pour moi de même nature que les êtres humains écorchés eux aussi que je dessine. Enfin, ils disent quelque chose de notre rapport au temps, de son extrême complexité, de sa légèreté...
Où en est aujourd'hui votre rapport avec la bande dessinée, avec ce qu'elle est et est devenue ?
J'ai été très marqué ces dernières années par Heimat, une bande dessinée de l'Allemande Nora Krug publiée par Gallimard. Je me suis demandé justement si l'on pouvait considérer que c'était de la bande dessinée. Et oui, bien sûr. Depuis vingt ans au moins, la BD s'est ouverte à tellement d'espaces nouveaux et différents. J'ai participé à cette ouverture. Certains me font l'honneur de penser que j'en ai été l'un des précurseurs. Si je l'ai été, c'est sans le savoir, comme Monsieur Jourdain. Au début, je ne connaissais pas la grammaire de la BD. Et puis, j'en ai acquis des notions. J'ai été trois ans professeur de bande dessinée au Québec, j'ai donc dû m'interroger sur tout cela. Comme quand j'ai travaillé sur les formats de manga. Donc, aujourd'hui, effectivement, je revendique cet héritage, dans toute sa diversité, y compris ses formes les plus classiques. J'ai une anecdote à ce sujet. Un jour, dans un salon, une jeune femme attachée au stand où je dédicaçais est venue me demander, embarrassée, si cela me gênait que l'on m'installe à côté du dessinateur des Tuniques bleues, Lambil. J'étais à mon tour presque gêné de sa question et surtout qu'elle ait pu imaginer que cela me gêne en quoi que ce soit. Mes enfants lisaient avec passion Les tuniques bleues, et moi aussi. Je suis admiratif du talent de Lambil et de son scénariste Cauvin, d'autant plus que je ne saurais pas faire ce genre de bandes dessinées.
Est-ce que le dessin a toujours été pour vous, en quelque sorte, « une chambre à vous » ?
Oui, le dessin est un « chez moi ». Quand on est dans l'exaltation du processus créatif, on est pleinement dedans. À l'heure où je vous parle, en résidence à Grenoble, dans le théâtre de la ville, depuis la terrasse, j'aperçois le Mont-Blanc. Une merveille que je désespère de pouvoir rendre par le dessin. Ou l'écriture, d'ailleurs. C'est par la BD que j'ai découvert l'écriture. Je n'étais avant qu'un simple titulaire d'un CAP d'aide-comptable... Numa Sadoul m'a fait découvrir la bande dessinée et j'ai découvert que j'aimais écrire. Mais cela ne suffit pas pour « dire » la montagne. Il faudrait la musique, la danse...
Y avait-il dans votre foyer d'enfance, des livres, des journaux, des BD ?
Rien de tout cela. Peut-être en cherchant bien quelques illustrés qui traînaient. Des fumetti comme on dit en Italie. Pepito, Blek le Roc, mais pour être franc, cela ne m'intéressait pas vraiment.
Comment vous est venue la passion du livre, de la littérature ?
Le premier livre qui m'ait vraiment marqué, vers 12 ou 13 ans, c'était Qu'elle était verte ma vallée de Richard Llewellyn. Je me suis dit qu'il était possible de communiquer le réel, voire de l'excéder. Après, vers quinze ans, ce fut Sartre et surtout Les chemins de la liberté. Et puis il y a eu Le procès-verbal de Le Clézio, mon voisin à Nice qui allait devenir mon ami. J'admire chez lui cette capacité à sonder à la fois les paysages, les territoires, les âmes, avec une extrême fluidité, une sensualité en fait. Aujourd'hui, parmi tant d'autres, l'œuvre d'une Toni Morrison est très importante pour moi. En fait, je lis constamment. Des bandes dessinées, mais plus encore de la littérature. C'est un oxygène qui m'est indispensable. Par exemple, je viens de finir le beau livre (sans dessins) de mon confrère dessinateur, Emmanuel Guibert, Mike.
Vous êtes un homme de gauche, vous avez beaucoup milité, encore récemment consacré un livre magnifique à la tragédie des migrants en Méditerranée et même été candidat sur une liste communiste pour des élections européennes. Où en êtes-vous aujourd'hui de votre engagement ?
Aujourd'hui, ma meilleure manière de militer, c'est de faire des livres. J'en ai parlé récemment avec mon amie Fred Vargas. Elle me disait, face aux urgences sociales et économiques de tous ordres, ne plus se sentir d'écrire encore de simples romans policiers, des enquêtes du commissaire Adamsberg, etc. Et puis finalement, elle y est revenue et je crois savoir que c'est ce qu'elle fait maintenant. Et je la comprends parfaitement. Dans son questionnement comme dans sa réponse. Vous allez penser que je change de sujet, mais en fait, non. L'important, c'est le bonheur, une certaine forme de joie. Pour tous, créateurs comme spectateurs. Je me souviens de spectacles de Pina Bausch, par exemple, qui ont pu me plonger dans une félicité infinie et me donner cette force infinie du bonheur. Alors, on peut courir, danser, marcher, faire silence ou bien l'amour et - pourquoi pas ? - faire la grève. Pour moi, aujourd'hui, ce bonheur a un nom : le livre, le livre, le livre... Comme celui que je viens de publier aux Éditions du Sonneur, J'ai pas tous les mots, qui même sans dessin, creuse ce sillon vers la joie.
Les fleurs de cimetière
L’Association
Tirage: 4 000 ex.
Prix: 30 € ; 288 p.
ISBN: 9782844148131