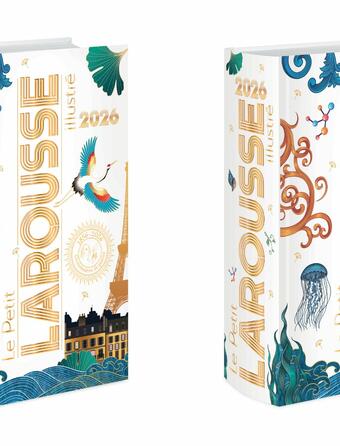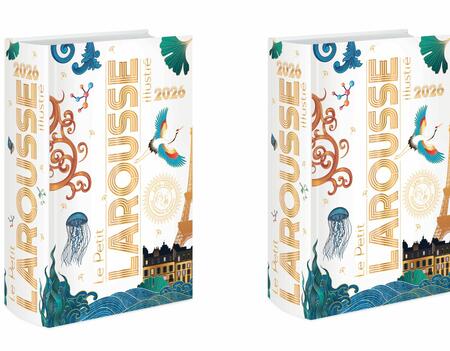Dans son troisième livre, Edouard Louis poursuit l’exploration fictionnelle de sa vie, remettant à vif des plaies pas vraiment cicatrisées, avec un important travail sur la forme littéraire. "Si ce texte était un texte de théâtre", écrit-il en incipit. Et en effet, Qui a tué mon père se présente comme un monologue en trois actes, dont le metteur en scène Stanislas Nordey, qui, d’après l’auteur, "a été à l’origine de ce texte", présentera une adaptation au théâtre de la Colline en 2019. Le spectacle tournera ensuite dans toute la France. On avait, dès ses débuts fulgurants (En finir avec Eddy Bellegueule, Seuil, 2014), remarqué l’oralité du style du jeune écrivain, lequel doit œuvrer dans un "gueuloir", comme disait Flaubert.
Louis a axé son livre autour du personnage de son père, qu’il revient visiter dans la petite ville du Nord où il s’est établi avec sa seconde femme, après qu’en 2009 son épouse avait chassé du domicile conjugal cet alcoolique violent, infidèle, dont "l’existence négative" a reproduit l’enfer vécu dans sa propre enfance, tout en l’imposant aux siens. Le narrateur s’adresse à lui à la deuxième personne, tandis qu’il parle toujours de "[sa] mère". Aujourd’hui, à 50 ans à peine, il le décrit comme un homme brisé, broyé à la suite d’un accident du travail, asphyxié, humilié, quasi réduit à la misère par la casse sociale dont il rend responsables les dirigeants successifs de notre pays: Chirac stigmatisant les malades, Sarkozy les "assistés" dont il a transformé le RMI en RSA, Hollande et Valls avec leur "loi Travail", ou encore Emmanuel Macron tapant sur les "fainéants" et économisant 5 euros sur les plus démunis. En quelque sorte, cette déroute a humanisé le père. Alors que, depuis sa naissance, il traitait son cadet de "pédé", le frappait, avait honte lorsque, pour jouer, il se travestissait en fille ou en majorette, il a désormais admis son homosexualité, achète ses livres et les offre même autour de lui.
Edouard en est fier et ému, lui qui a toujours voulu capter l’attention de ce père, exister à ses yeux, être aimé de lui comme lui l’aime, mot difficile à prononcer dans cette famille de taiseux où, au final, on ne se parlait pas. "Il me semble souvent que je t’aime", dit le narrateur et, ailleurs, "est-ce qu’il est normal d’avoir honte d’aimer ?". Toute la question est là, quand on a vécu une histoire aussi douloureuse, dont, à rebours de la chronologie, plusieurs épisodes sont rappelés, certains d’une grande violence. Toute l’œuvre d’Edouard Louis tourne autour d’elle: subie, exercée sur les autres, rendue, infligée par la société, la violence est partout. L’espérance aussi, selon Apollinaire. On espère qu’il avait raison. Le père, lui, appelle de ses vœux "une bonne révolution". C’est le dernier mot de ce livre "engagé", aussi bref qu’intense. Jean-Claude Perrier