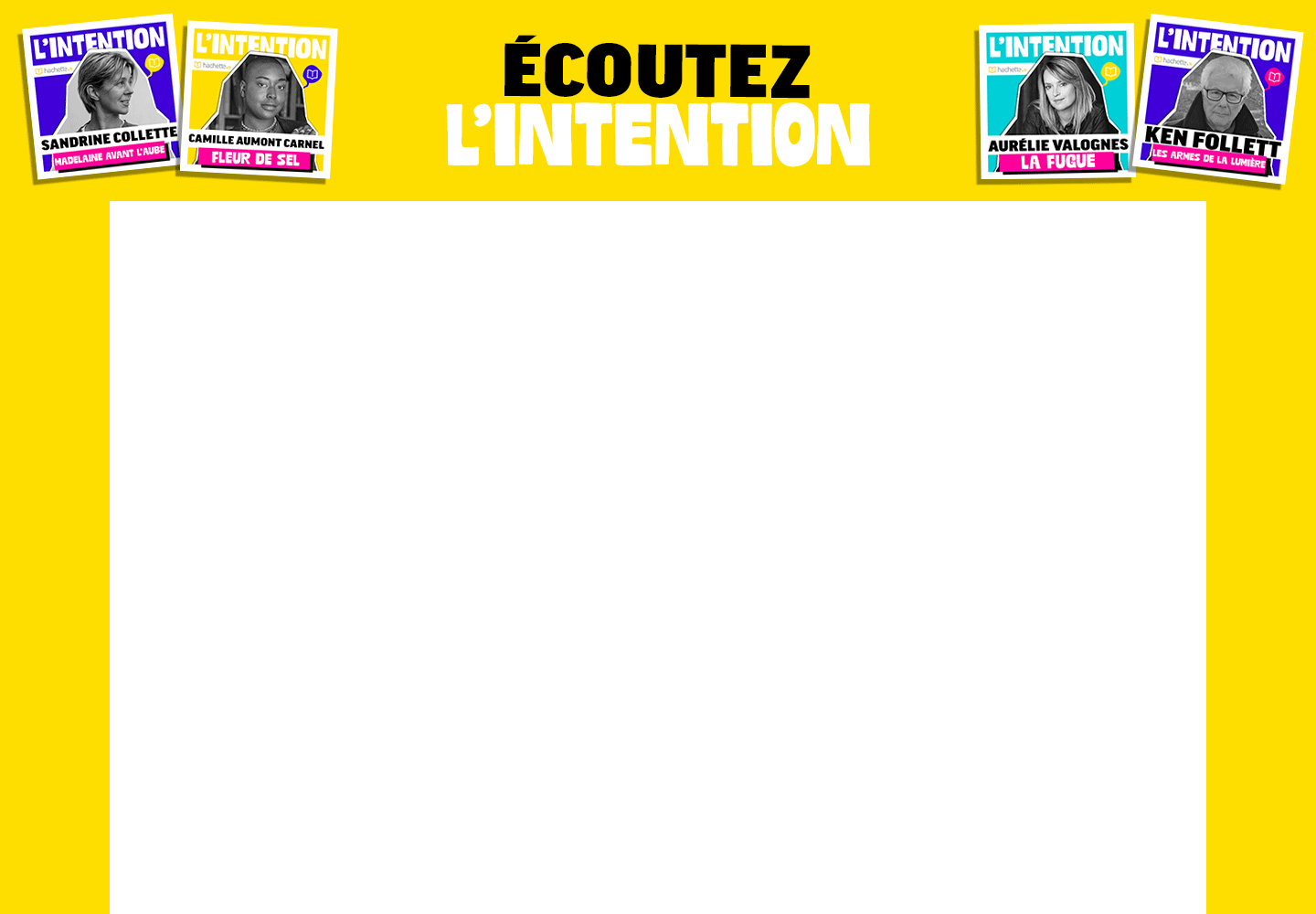Livres Hebdo : Comment avez-vous commencé dans l’édition ?
Pierre Dutilleul : J’ai suivi des études de gestion à Dauphine, dont je suis sorti en 1974. Et en même temps, j’étais passionné de radio. J’ai commencé à Europe 1, puis j’ai créé ma propre radio, qui fonctionne encore aujourd’hui. Une radio libre, associative, à Cergy-Pontoise. J’y ai tout fait : les magazines, des émissions de musique classique, de rock, le journal, la direction… À Cergy, il y a une école de commerce qui s’appelle l’ESSEC, et des barres d’immeubles parfois difficiles. Mon projet, qui a séduit les autorités locales et départementales, c’était de réunir les deux et de faire en sorte que ceux qui venaient des barres d’immeubles ne soient pas les techniciens, et ceux venant de l’ESSEC, les voix, mais qu’ils travaillent ensemble indifféremment. Ensuite, j’ai travaillé chez un éditeur de logiciels et de matériel informatique. Je voulais comprendre la comptabilité, la finance, l’informatique, comment m’en servir. Ça a été une plateforme d’apprentissage et de lancement.
Vous êtes donc arrivé dans l’édition après une première carrière assez dense…
Oui, en 1989, je suis entré au Groupe de la Cité, une filiale de CEP communication – elle-même filiale d’Havas – lancée par Christian Brégou. Il disposait d’une sorte d’empilement de maisons d’édition, dans tous les domaines : scolaire, référence, littérature… Mais il n’y avait aucune logique de groupe. Il m’a demandé de créer un langage commun de gestion pour toutes ces maisons. Que ce soit Larousse ou Plon, Bordas ou Nathan… Je lui avais répondu que ce qui m’intéressait, c’était l’édition. Il avait clos la conversation en disant : « Ça, c’est votre problème ; rêvez avec. Moi, voilà mon projet, c’est oui ou non. » Et j’ai dit oui.
Trois ans après, son assistante m’a appelé pour me donner rendez-vous à 18 h 30 le jour même. Et Christian Brégou m’a dit : « Vous m’avez fait un dossier pour réorganiser la littérature générale ; mutualiser tout ce qui peut être mutualisable, pour que les éditeurs ne fassent que de l’édition et plus de la diffusion, de la distribution. Ça vous intéresse de la piloter ? » J’ai répondu : « Et comment ! » Et il a ajouté : « Vous vous souvenez de notre conversation, il y a trois ans ? On la reprend aujourd’hui. Vous commencez à 8 h 30 demain matin. »
J’ai créé la société de mutualisation qui existe encore aujourd’hui, la Sogedif. Mutualiser l’ensemble des maisons de littérature générale, les existantes (Plon, Perrin, les Presses de la Cité…) et celles qu’on a rachetées en cours de route (Belfond, La Découverte,…). J’ai également créé une petite maison d’édition qui s’appelle les Presses de la Renaissance, qui existait mais ne produisait plus, dédiée à la spiritualité.
C’est un sujet important à vos yeux ?
Ça m’intéressait, mais je n’étais pas militant. Je trouvais surtout dommage que ce type de titres n’ait pas accès à la grande distribution. À l’intérieur d’un groupe, je pouvais faire que ça change, grâce à Interforum. C’était une belle aventure, et aujourd’hui, la collection « Presses de la Renaissance » est un département des éditions Plon.
Peut-on dire que vous avez plus été un manager ou un cadre de l’édition qu’un éditeur ?
J’ai fait les deux. J’ai notamment dirigé Belfond, qu’on venait de racheter. Ça a été ma première expérience de direction d’une maison d’édition. Dès le premier jour, j’ai commencé à travailler avec les auteurs de Belfond, des Presses de la cité ; les français comme les étrangers. On a lancé Françoise Bourdin, Harlan Coben, Frank McCourt… J’ai beaucoup travaillé avec des auteurs. J’aime beaucoup les auteurs, et en même temps, on ne peut pas se désintéresser de la diffusion, de la distribution et de la gestion ; c’est un tout.
Quand on est patron d’une maison, c’est une PME, avec son personnel, ses clients, ses fournisseurs. On ne peut pas refuser de gérer ça. Alors que quand on est éditeur à l’intérieur d’une maison d’édition, qu’on dirige une collection, à ce moment-là on peut se concentrer pleinement sur le travail avec les auteurs. Il n’y a plus de gestion quotidienne de toutes ces fonctions. C’est pourquoi les maisons d’Editis disposent d’un secrétaire général qui s’occupe notamment des relations avec la société de mutualisation, et que les éditeurs peuvent vraiment faire de l’édition.
En parallèle, je suis devenu directeur général des Presses Solar-Belfond, et vice-président de l’ensemble de ce groupe. On a également racheté La Découverte. La maison était en grande difficulté, et la mutualisation lui a permis de revenir à l’équilibre. Elle était dirigée par François Gèze, avec lequel on s’est partagé les rôles. En dix-huit mois, on était repassé en positif.
Ce travail de rationalisation s’est fait alors que le groupe a changé plusieurs fois d’actionnaires.
Havas avait été repris en 1998 par la Compagnie générale des eaux, et l’ensemble est devenu Vivendi, sous l’impulsion de Jean-Marie Messier, que j’ai beaucoup apprécié comme patron. Il était extraordinaire dans son management des dirigeants de maisons, même si ce qui s’est passé au niveau du groupe m’échappait complétement. C’est à cette époque que j’ai rejoint les éditions Masson, et Vivendi a racheté Le Quotidien du médecin, le dictionnaire Vidal des médicaments… On en a fait un Groupe et on m’a demandé de prendre la présidence de cette entité pour la France et le Bénélux, pour créer un ensemble santé appelé Médimédia. J’ai donc lâché ce que je ne pouvais plus assumer, et je suis resté trois ans dans ce domaine de la santé. On travaillait avec les sociétés savantes, émanations des grandes spécialités médicales, ce qui était passionnant. Les médecins de cette époque avaient fait leurs humanités, comme on dit. J’ai le souvenir du professeur Dubernard, qui était un grand chirurgien, un écrivain remarquable et un travailleur acharné. Dès cette époque, le numérique était omniprésent.
Puis, le 1er juillet 2002, on m’a demandé de prendre la présidence de SEJER, la structure d’éducation et de référence (Nathan, Bordas, Le Robert…). Là encore, il s’agissait de mutualiser et de diriger la structure de mutualisation. J’ai accepté cette responsabilité le jour où Messier a été démis de ses fonctions. Le Groupe allait changer !
C’est à ce moment-là qu’a eu lieu la première tentative de rapprochement entre Editis et Hachette.
On a été mis en vente dès le mois d’aout et, avec Alain Kouck, qui était alors le président du groupe, on a consacré l’essentiel de notre temps au rapprochement avec Lagardère. Je suis beaucoup allé à Bruxelles, mon abonnement au Thalys a été bien rentabilisé… Finalement, le groupe a été coupé en deux, et on a dû « détourer » l’ensemble puisque nous avions mutualisé beaucoup de fonctions et qu’on enlevait Larousse, Dalloz, Dunod, Armand Colin…, qui rejoignaient Hachette.
Après bien des rebondissements, on a été repris par Wendel ; puis Wendel a vendu Editis à Planeta en 2008, ce qui a provoqué un mouvement social. Alain Kouck m’a alors demandé de m’en occuper, car les syndicats demandaient à me parler à moi.
Parce que vous aviez su lâcher du lest dans vos postes précédents ?
Pas forcément. J’avais toujours fait mon maximum pour négocier, écouter – beaucoup –, établir un bon dialogue social. Je suis donc devenu DRH d’Editis, et je le suis resté sept ans. J’étais également directeur délégué, car à la faveur d’un changement d’organisation, j’ai pris en charge l’institutionnel, la communication et les affaires internationales… Et puis j’ai reçu un coup de fil de Vincent Montagne, qui me proposait la direction générale du SNE. Or, j’avais un peu l’impression que j’avais fait mon temps chez Editis.
Retrouvez la suite de l'interview de Pierre Dutilleul, dans laquelle il aborde ses années comme directeur général du SNE, la semaine prochaine sur livreshebdo.fr.