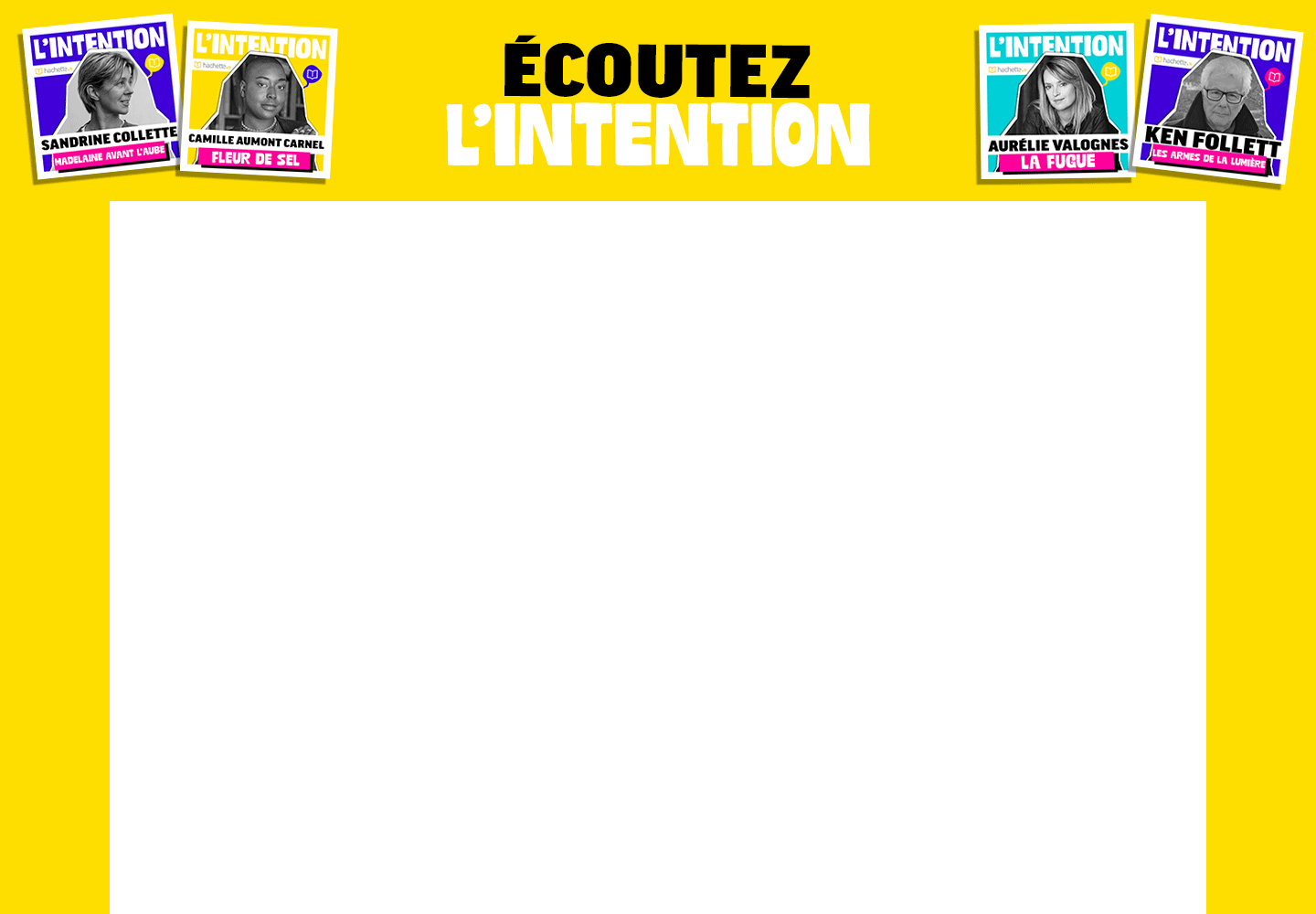C’est un premier roman, un récit d’initiation peu commun, qui a tout de suite propulsé son auteur, Daniel Magariel, parmi les écrivains les plus en vue aux Etats-Unis. One of the boys a en effet été sacré meilleur livre de l’année 2017 par les critiques du New York Times. Ce One, c’est le jeune narrateur, le cadet de la terrible famille où se passe l’histoire, dont on espère qu’elle n’est pas autobiographique.
Dans la famille - dont on ne connaîtra ni le nom ni les prénoms des quatre membres -, qui vit à l’origine au Kansas, il y a le père, conseiller financier, la mère, à qui il reproche de se faire virer de tous ses jobs, et leurs fils, que deux ans séparent. Deux parfaits garçons américains, sportifs, fans et pratiquant le basket, débrouillards, organisés, plutôt "cool", et liés l’un à l’autre par une affection fusionnelle. Le couple vient de voler en éclats de manière conflictuelle. Le père accuse sa femme de tous les maux, et il a obtenu la garde de ses fils, après que le cadet, manipulé, a menti à la justice pour charger sa mère. On apprendra en fait que les torts étaient plutôt partagés, et que le père, déjà dépendant de diverses drogues, se montrait brutal, violent, et frappait sa femme. Mais quand il est "clean", il peut être charmant, et ses fils l’adorent. Aussi, c’est avec enthousiasme que tous trois partent s’installer à Albuquerque, Nouveau-Mexique, afin de "retrouver l’esprit", dixit le père, leurs racines latinos, et de jouer les cow-boys à la manière de l’ancien temps.
Ils vont vite déchanter. Les garçons ont du mal à s’intégrer au lycée. Surtout, le père part totalement en vrille. Au début, il boit, fume et se shoote un peu. Puis, il se défonce complètement au crack, arrive à peine à travailler, se querelle avec tout le monde (notamment l’entraîneur de basket), s’adonne à de sinistres orgies devant ses fils, qu’il réduit en esclavage, humilie, isole du monde et commence à cogner avec une férocité extrême. L’argent manque. Leur calvaire va durer des mois. La mère appelée au secours, encore amoureuse et craintive de son mari, se révèle incapable de les aider. Ce n’est qu’à la toute fin du roman (bizarre, d’ailleurs, comme l’épilogue) que le lecteur suppose, et espère, qu’ils seront sauvés. C’est âpre, fort, porté par une écriture d’une redoutable simplicité, brillant et angoissant à la fois. J.-C. P.